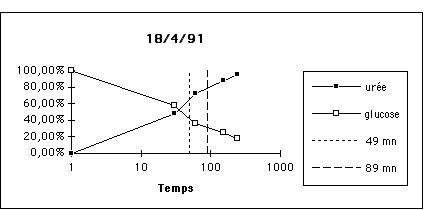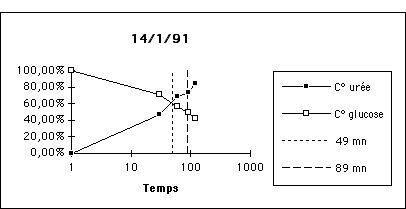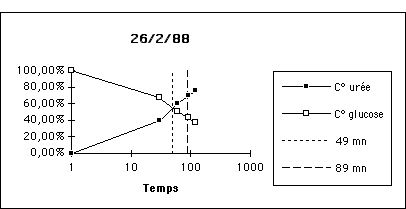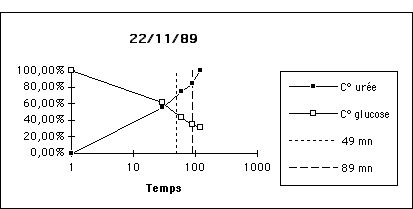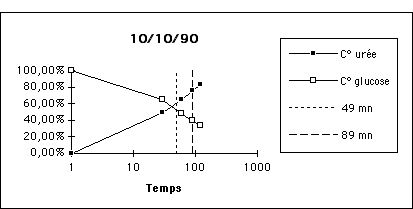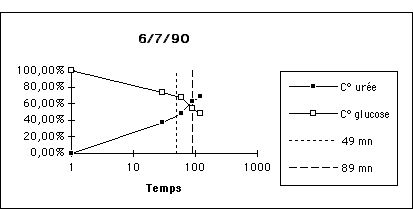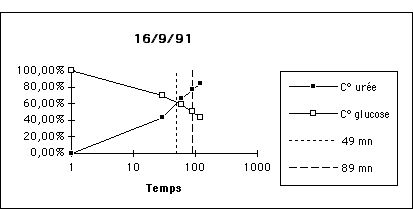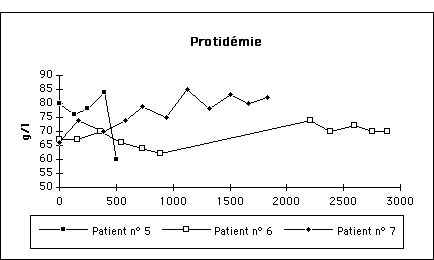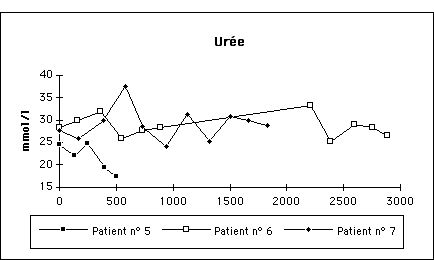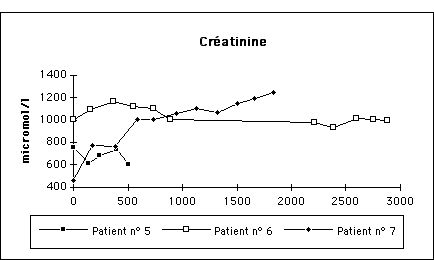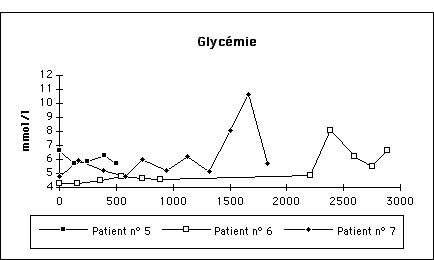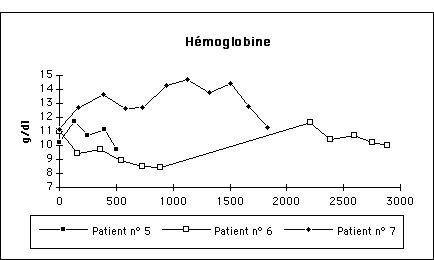Place actuelle
de la dialyse péritonéale
Observations
Elles concernent huit patients au total du service de néphrologie
et de dialyse du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg et de l’Association
Lorraine pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (ALTIR) de Nancy.
Les résultats que nous rapportons ont fait en partie l’objet de publications
préliminaires [36,54].
Observation n° 1
La première observation concerne une femme âgée de 60
ans qui présente une cirrhose éthylique de type B dans la classification
de Child (hypertension portale clinique patente et insuffisance hépato-cellulaire
sévère, score de Pugh à 10). Cliniquement on notait
la présence de varices œsophagiennes de stade II, d’une splénomégalie
et d’une circulation abdominale collatérale. Le facteur V était
à 25 %, le taux de prothrombine à 50 % et l’albuminémie
à 20 g/l.
Elle a été hospitalisée en raison d’une insuffisance
rénale aiguë anurique avec un syndrome néphritique aigu
hypocomplémentaire dont l’étiologie est une glomérulonéphrite
aiguë survenant lors de l’évolution d’un érysipèle.
La phase anurique initiale est rapidement réversible après
une semaine de dialyse péritonéale réalisée par
l’intermédiaire d’un cathéter de Tenckhoff à un manchon
mis en place par voie per-cutanée.
Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:
|
Durée de traitement
|
1ère semaine |
| D/P Créatinine (4 h) |
0,92
|
|
D/P Urée (4 h)
|
0,93
|
|
Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)
|
62
|
|
Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)
|
70
|
|
KT/V urée (par semaine)
|
2,19
|
|
Ultrafiltration (l pour un 1,36% sur 4 h)
|
0,400
|
|
Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)
|
1,000
|
Cette observation, quoiqu’incomplètement documentée, montre
cependant chez cette patiente un profil d’hyperperméabilité
péritonéale alors que l’ultrafiltration reste élevée.
Les clairances sont également parfaitement correctes
Cette patiente a malheureusement été perdue de vue dans les
suites de cet épisode et son évolution à long terme
est inconnue.
Observation n° 2
Cette observation concerne un homme de 55 ans éthylique présentant
également une cirrhose éthylique de type B dans la classification
de Child, caractérisée par une hypertension portale clinique
avec une hématémèse en relation avec une gastropathie
érosive et d’une évolution favorable malgré la sévérité
de l'insuffisance hépato-cellulaire aggravée par un épisode
d’hépatite alcoolique aiguë récent (score de Pugh à
10). Cliniquement on notait la présence de varices œsophagiennes de
stade I, d’une splénomégalie, d’une circulation abdominale
collatérale et d’angiomes stellaires nombreux. Le facteur V était
à 34 %, le taux de prothrombine à 43 % et l’albuminémie
à 18 g/l.
Ce patient a été hospitalisé en raison d’une insuffisance
rénale aiguë anurique. Ici encore il s’agit d’un syndrome néphritique
aigu hypocomplémentaire ayant succédé à un épisode
de bronchopathie fébrile survenu quelques semaines auparavant. La
ponction-biopsie rénale effectuée devant une anurie complète
et prolongée établit l’existence d’une glomérulonéphrite
proliférative endocapillaire diffuse.
Ce patient connaîtra une période d’anurie de trois mois dont
la résolution tardive s’accompagnera de la normalisation du profil
complémentaire.
Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:
|
Durée de traitement
|
5ème semaine
|
12ème semaine
|
|
D/P Créatinine (4 h)
|
0,86
|
0,81
|
|
D/D0 Glucose
(4 h)
|
0,17
|
0,28
|
|
D/P Urée (4 h)
|
0,95
|
0,92
|
|
Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)
|
66
|
61
|
|
Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)
|
74
|
62
|
|
Ultrafiltration (l pour un 1,36% sur 4 h)
|
|
0,660
|
0,600
|
|
Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)
|
|
1,280
|
1,150
|
|
KT/V urée (par semaine)
|
|
1,74
|
1,63
|
|
Protéines du dialysat (g/24 h)
|
|
5,5
|
5,7
|
L’exploration péritonéale montre encore un profil d’hyperperméabilité
avec des saturations en urée et créatinine du dialysat très
élevées et un coefficient d’absorption glucidique également
élevé, alors que l’ultrafiltration reste paradoxalement à
un niveau supérieur à la normale. On peut également
remarquer que les pertes protéiques restent tout-à-fait acceptables
et plutôt inférieures à celles habituellement observées
en dialyse péritonéale. D’ailleurs l’albuminémie va
évoluer favorablement de 18 g/l à l’hospitalisation à
24 g/l à la sortie du patient. Les clairances permettent une dialyse
d’excellente qualité avec seulement trois échanges quotidiens
de 2 litres de solution isotonique.
Le sevrage éthylique a été obtenu chez ce patient et
a pu être maintenu après la sortie du patient qui va actuellement
bien, sa fonction rénale étant normalisée.
Observation n° 3
Il s’agit d’une femme de 43 ans éthylique chronique hospitalisée
en Avril 1991 à l’occasion d’une deuxième décompensation
ictéro-ascitique d’une hépatopathie éthylique et traitée
pour une insuffisance rénale aiguë.
Elle présentait cliniquement un ictère cutanéo-muqueux
intense et une ascite volumineuse ainsi qu’une oligo-anurie inférieure
à 300 ml par jour. On notait également une circulation collatérale
abdominale et des angiomes stellaires. L’haleine était fétide
mais il n’y avait pas d’encéphalopathie à l’entrée.
La patiente ne présentait pas de signes clinique de déshydratation
et sa situation hémodynamique était stable (pression artérielle
à 120/60 mmHg et pression veineuse centrale entre 5 et 12 cm d’eau).
Il n’y avait pas de varices œsophagiennes, mais l’échographie retrouvait
des stigmates nets d’hypertension portale et une splénomégalie.
Biologiquement il existait une hyperbilirubinémie à 564 µmol/l,
des g-GT à 101 UI/l et une ammoniémie à 83 µmol/l.
Il existait une légère cytolyse et les sérologies virales
de même que le dosage de l’a-FP étaient normaux. Le TP était
à 55 %, le facteur V à 50 %, l’albuminémie à
31 g/l. Le taux de protéines dans le liquide d’ascite était
de 10 g/l. Ce tableau correspond à un score de 10 sur l’échelle
de Pugh (classe B de Child et Turcotte).
Sur le plan de la fonction rénale la créatininémie
était à 861 µmol/l avec une urée sanguine à
25,7 mmol/l. La natriurèse sur échantillon était indosable
et le sédiment urinaire ne montrait pas d’anomalie en dehors d’une
protéinurie minime de 0,44 g/l. Il n’y a pas eu de ponction-biopsie
rénale.
Le diagnostic retenu a été celui d’un syndrome hépatorénal
venant compliquer une hépatite alcoolique aiguë.
Elle a été traitée par dialyse péritonéale
(le cathéter étant implanté au lit de la malade sous
couvert d’une transfusion de PPSB et antibioprophylaxie) et perfusion de
dopamine à la dose de 3 µg/Kg.mn, de 360 mg de furosémide
par jour et d’albumine, ce qui a permis de relancer la diurèse et
d’aboutir à une fonction rénale subnormale (créatininémie
à 113 µmol/l au 13ème jour) pendant que, dans
le même temps, la fonction hépatique revenait à la normale.
La dialyse a été arrêtée après 13 jours
de traitement, le cathéter étant laissé en place pendant
encore une semaine de façon à obtenir un assèchement
de l’ascite.
Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:
|
Durée de traitement
|
3ème jour
|
10ème jour
|
|
D/P Créatinine (4 h)
|
1,00
|
0,99
|
|
D/P Urée (4 h)
|
0,98
|
1,00
|
|
Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)
|
51
|
51
|
|
Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)
|
51
|
51
|
|
KT/V urée (par semaine)
|
1,45
|
1,45
|
|
Ultrafiltration (l pour un 13,6% sur 4 h)
|
0,400
|
0,450
|
|
Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)
|
1,485
|
|
|
Protéines du dialysat (g/24 h)
|
23,7
|
18,4
|
Un test d’équilibration a été effectué au troisième
jour d’évolution et donne le temps APEX de 23 mn, correspondant à
une hyperperméabilité très importante, qui reste encore
dans ce cas paradoxalement compatible avec une bonne ultrafiltration (malgré
la restauration par ailleurs d’une diurèse quotidienne d’un litre
à un litre et demi), mais chez cette patiente les fuites protidiques
dans le dialysat sont élevées et imposent une supplémentation
en albumine pendant toute la durée du traitement.
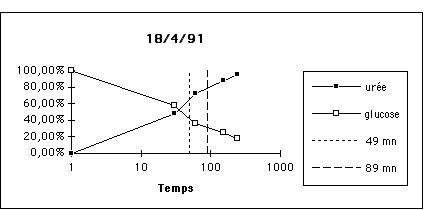
Avec deux ans de recul, cette patiente, actuellement sevrée de son
intoxication alcoolique, va parfaitement bien et n’a pas de séquelles
de cet épisode.
Observation n° 4
Il s’agit d’un patient de 41 ans, cirrhotique (score de 9 sur l’échelle
de Pugh, classe B de Child et Turcotte) et éthylique, suivi depuis
deux ans pour une hématurie microscopique et un syndrome néphrotique
impur avec à la biopsie rénale une glomérulonéphrite
membrano-proliférative à dépôts d’IgA.
Il a été mis en dialyse en octobre 1991 à l’occasion
d’une poussée évolutive aiguë de son insuffisance rénale
avec anurie et décompensation œdémato-ascitique ayant entraîné
une prise de poids de 25 Kg. Le cathéter initialement mis en place
au lit du malade a été repositionné chirurgicalement
en novembre 1991 à l’occasion d’une cure de hernie inguinale.
Le suivi en dialyse péritonéale s’est fait alors sans difficulté
technique majeure en dehors d’une péritonite à Escherichia
Coli en janvier 1992.
Ce patient a dû être transféré en hémodialyse
en février 1992 après 3 mois de traitement en raison d’une
tentative de suicide par arme blanche avec plaie abdominale et section du
cathéter de dialyse traduisant probablement un rejet total de la technique.
Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:
|
Durée de traitement
|
6ème semaine
|
10ème semaine
|
|
D/P Créatinine (4 h)
|
0,97
|
0,97
|
|
D/D0 Glucose (4 h)
|
0,17
|
|
|
Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)
|
51,6
|
53
|
|
Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)
|
52
|
54
|
|
KT/V urée (par semaine)
|
1
|
1,02
|
|
Ultrafiltration (l pour un 1,36% sur 4 h)
|
0,500
|
0,600
|
|
Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)
|
1,290
|
1,850
|
|
Protéines du dialysat (g/24 h)
|
7,46
|
|
On retrouve dans cette observation une hyperperméabilité péritonéale
avec une capacité d’ultrafiltration plus que conservée et des
pertes protidiques acceptables permettant la poursuite de la technique malgré
une albuminémie initiale de 22 g/l. L’équilibre dialytique
a d’ailleurs été obtenu chez ce patient avec seulement trois
échanges quotidiens de 2 litres de solution isotonique.
Cette observation permet d’attirer l’attention sur le fait que la prise
en charge en dialyse d’un patient est un acte qui doit considérer
l’individu-patient dans sa globalité et non seulement sa situation
biologique au sens technique du terme. La survie au prix d’un coût
affectif excessif en raison d’une technique inadaptée ou trop lourde
n’est pas forcément souhaitable et le choix de la stratégie
thérapeutique doit en tenir compte. De plus, chez ce patient, le sevrage
éthylique, imposé par l’équipe médicale, n’a
pas pu être maintenu plus de quelques semaines.
Observation n° 5
Il s’agit d’une patiente de 49 ans, porteuse d’une cirrhose éthylique
de type B prouvée histologiquement, ayant fait deux épisodes
de décompensation œdémato-ascitique en 1986 et 1988 et sevrée
de son intoxication éthylique depuis 1988.
Sur le plan néphrologique, elle souffre d’une hypertension artérielle
sévère ancienne avec une insuffisance rénale longtemps
modérée. La ponction-biopsie rénale montre des lésions
de glomérulonéphrite chronique avec des dépôts
mésangiaux d’IgA sur tous les glomérules et des dépôts
de C1q, de C3 et de C4.
En juillet 1990 intervient une décompensation aiguë de l’insuffisance
rénale avec œdèmes des membres inférieurs et œdème
aigu du poumon avec une créatininémie à 424 µmol/l.
La patiente est alors prise en charge par le service de néphrologie
de l’hôpital de Nancy et la mise en dialyse intervient en novembre
1990 avec l’insertion d’un cathéter de Tenckhoff.
Il n’y a pas eu de difficulté technique majeure et en particulier
aucune complication infectieuse depuis la prise en charge en dialyse.
Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:
|
Durée de traitement
|
2 mois
|
|
D/D0 Glucose (2 h)
|
0,38
|
|
D/P Urée (2 h)
|
0,84
|
|
Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)
|
49
|
|
Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)
|
70
|
|
KT/V urée (par semaine)
|
2,05
|
|
Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)
|
1,300
|
|
Protéines du dialysat (g/24 h)
|
7,2
|
Chez cette patiente ayant une diurèse résiduelle de 700 ml
par jour, les clairances totales de la créatinine et de l’urée
sont respectivement de 9,2 ml/mn/1,73 m2 (soit 92 l/semaine) et de 9,4 ml/mn/1,73
m2 (soit 94 l/semaine). Trois échanges quotidiens seulement suffisent
à obtenir ces résultats.
Le temps APEX calculé est de 47 mn, ce qui correspond à un
profil d’hyperperméabilité sans perte d’ultrafiltration, avec
des pertes protidiques restant dans la moyenne de celles habituellement observées
en dialyse péritonéale. La variation du sodium est normale
(baisse de 133 à 116 mEq/l).
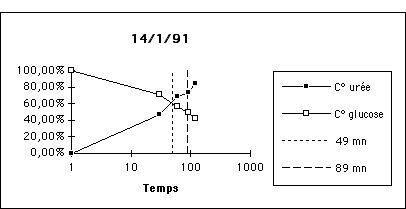
Observation n° 6
Il s’agit d’un patient de 46 ans à la mise en dialyse péritonéale,
suivi depuis 1955 pour une glomérulonéphrite chronique découverte
à l’âge de 20 ans lors du service national en raison d’une protéinurie.
L’insuffisance rénale apparaît en 1965 et le patient est hémodialysé
de 1969 à 1971, date à laquelle il bénéficie
d’une greffe rénale. En 1979, à 44 ans , une ascite nécessitant
des ponctions itératives apparaît, accompagnée de varices
œsophagiennes de grade III, d’une hypertension portale et d’une splénomégalie,
correspondant cliniquement à une cirrhose hépatique de type
B. La biopsie hépatique (en 1979) montre des signes de stéatose
touchant environ 50 % des cellules visibles. Une seconde biopsie hépatique
est tentée en 1988 par voie transjugulaire mais le prélèvement
est techniquement trop insuffisant (cinq fragments de très petite
taille et très dissociés) pour que l’anatomo-pathologiste puisse
donner un diagnostic certain. Biologiquement on note un taux de prothrombine
entre 75 et 80 %. En août 1980 la créatininémie est à
200 µmol/l. L’aggravation de l’insuffisance rénale impose la
mise en dialyse péritonéale en octobre 1981.
L’évolution en dialyse est marquée par la survenue d’une dizaine
de péritonites en 12 ans. Il faut cependant remarquer que sept de
ces péritonites interviennent dans les quatre premières années.
Il s’agit de trois péritonites à Staphylocoque (dont une à
Staphylocoque Aureus et deux à Staphylocoque Epidermidis) et d’une
péritonite à Serratia, le germe n’étant pas retrouvé
dans les trois autres cas. Avec l’adoption de systèmes déconnectables,
on ne retrouve que trois épisodes de péritonites en huit ans,
dont deux péritonites à Staphylocoque Aureus secondaires à
une infection du tunnel et ayant nécessité à deux reprises
le changement de cathéter et une péritonite à corynébactérie.
En 1987, soit après 6 ans de dialyse péritonéale, l’aggravation
d’une hyperparathyroïdie secondaire à l’insuffisance rénale,
devenue incontrôlable par le traitement médical, a nécessité
une parathyroïdectomie.
Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:
|
Durée de traitement
|
6 ans
|
8 ans
|
9 ans
|
|
D/D0 Glucose (4 h)
|
0,26
|
0,21
|
0,32 (2 h)
|
|
D/P Urée (4 h)
|
0,89
|
1,00
|
0,83 (2 h)
|
|
Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)
|
|
|
64
|
|
Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)
|
|
|
66
|
|
KT/V urée (par semaine)
|
|
|
2,09
|
|
Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)
|
0,920
|
0,800
|
0,300
|
|
Protéines du dialysat (g/24 h)
|
|
|
4,7
|
A plusieurs reprises les courbes d’équilibration mettent en évidence
une perméabilité normale, puis une hyperperméabilité
nette :
- 11/86 Perméabilité normale. Ultrafiltration 1060 ml.
- 02/88: Perméabilité normale. Ultrafiltration 920 ml. APEX
51 mn. Variation du sodium normale (de 130 à 125 mEq/l)
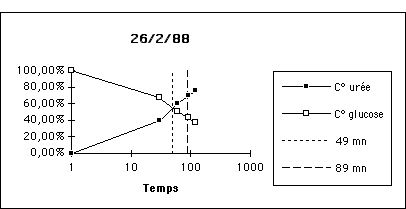
- 11/89: Hyperperméabilité. Ultrafiltration 800 ml. APEX
34 mn. Variation du sodium anormale (de 133 à 133 mEq/l)
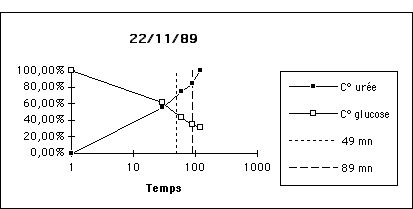
- 10/90: Hyperperméabilité. Ultrafiltration 300 ml. APEX
42 mn. Variation du sodium anormale (de 132 à 134 mEq/l)
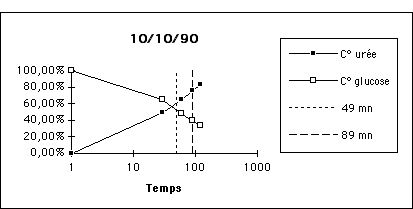
Là encore on assiste à la coexistence d’une hyperperméabilité
permettant une excellente qualité de dialyse et d’une ultrafiltration
paradoxalement élevée.
Les pertes protéiques restent tout-à-fait dans les limites
habituelles en dialyse péritonéale.
Observation n° 7
Il s’agit d’un patient de 53 ans à la mise en dialyse péritonéale,
souffrant d’une cirrhose post-hépatitique depuis 1969 et présentant
également un délire psychotique depuis une vingtaine d’année.
L’insuffisance rénale est découverte à la suite d’une
infection urinaire en 1984; on met alors en évidence une protéinurie
et une hématurie microscopique. La biopsie rénale est effectuée
en mars 1985 devant un syndrome néphrotique impur avec insuffisance
rénale modérée et met en évidence une glomérulonéphrite
membrano-proliférative à dépôts d’IgA. La cirrhose
s’accompagne de varices œsophagiennes de grade II et d’un hypersplénisme
(cirrhose de type B). La mise en dialyse péritonéale intervient
en 1986 devant l’aggravation rapide de l’insuffisance rénale sans
facteur déclenchant évident. La dialyse péritonéale
est choisie en raison de l’état hépatique du patient.
L’évolution en dialyse péritonéale se fait sans incident
notable en dehors d’une péritonite à Staphylocoque coagulase-négatif
à la suite d’une erreur de manipulation en août 1991.
Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:
|
Durée de traitement
|
4 ans
|
5 ans
|
|
D/D0 Glucose (2 h)
|
0,48
|
0,38
|
|
D/P Urée (2 h)
|
0,68
|
0,85
|
|
Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)
|
60
|
54
|
|
Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)
|
56
|
63
|
|
KT/V urée (par semaine)
|
1,38
|
1,56
|
|
Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)
|
0,560
|
0,680
|
|
Protéines du dialysat (g/24 h)
|
10,1
|
11,8
|
Les pertes protidiques sont ici à la limite supérieure de
ce qui est retrouvé habituellement en dialyse péritonéale,
sans que la protidémie du patient en soit affectée ainsi que
nous le verrons plus loin.
Les explorations de la perméabilité péritonéale
mettent en évidence chez ce patient une fonction péritonéale
normale:
- 07/90: Perméabilité normale. Ultrafiltration 560 ml. APEX
78 mn. Variation du sodium normale (de 127 à 120 mEq/l)
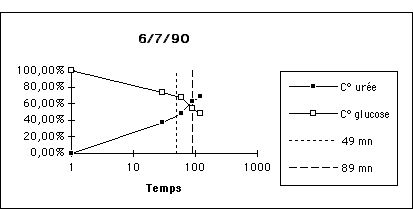
- 09/91: Perméabilité normale. Ultrafiltration 680 ml. APEX
50 mn. Variation du sodium normale (de 130 à 124 mEq/l)
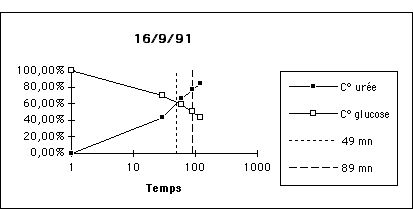
Observation n° 8
Il s’agit d’un patient de 55 ans, souffrant d’une cirrhose éthylique
de type B ayant entraîné à l’âge de 49 ans une
première décompensation avec une hémorragie digestive
par varices œsophagiennes, un coma avec complications pulmonaires et neurologiques
graves et en particulier deux arrêts cardiaques. Le sevrage alcoolique
est obtenu à 52 ans, soit trois ans avant la mise en dialyse péritonéale.
Il existe également un diabète non-insulino-dépendant
traité par régime et une hypertension artérielle.
Sur le plan néphrologique on note un épisode d’hématurie
en 1981 à l’âge de 51 ans. Une insuffisance rénale modérée
avec une hématurie microscopique et une protéinurie à
1,46 g/24 h est découverte en 1982. Le diagnostic étiologique
de cette insuffisance rénale reste hypothétique en l’absence
de biopsie rénale (néphroangiosclérose ou néphropathie
à dépôts d’IgA). La mise en dialyse est décidée
en 1985 en raison de l’aggravation progressive de l’insuffisance rénale,
avec l’apport d’insuline, le régime ne suffisant plus à équilibrer
le diabète.
La dialyse péritonéale est poursuivie sans incident jusqu’en
1988 en dehors d’un épisode de péritonite sans germe identifié
en mars 1988.
Le patient décède en mai 1988 en raison d’un arrêt cardiaque
en relation avec un adénocarcinome hépatique.
Pendant les quatre ans de la dialyse, la technique a été bien
supportée et le patient a pu se prendre en charge à domicile.
Les explorations fonctionnelles péritonéales n’ont pas été
effectuées chez ce patient dont le dossier a été repris
rétrospectivement pour cette étude.
Récapitulation
Les paramètres biologiques de la dialyse des 7 patients ayant bénéficié
d’une exploration de la qualité de leur dialyse sont rappelés
dans le tableau suivant:
|
Patient n°
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
D/P Créatinine (4 h)
|
0,92
|
0,86
|
1,00
|
0,97
|
|
|
|
|
D/D0 Glucose (4 h)
|
|
0,17
|
|
0,17
|
0,38(2h)
|
0,32(2h)
|
0,38(2h)
|
|
D/P Urée (4 h)
|
0,93
|
0,95
|
0,98
|
|
0,84(2h)
|
0,83(2h)
|
0,85(2h)
|
|
Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/semaine)
|
62
|
66
|
51
|
51,6
|
49 (92)
|
64
|
54
|
|
Clairance de l’urée (l/1,73 m2/semaine)
|
70
|
74
|
51
|
54
|
70 (94)
|
66
|
63
|
|
KT/V urée (par semaine)
|
2,19
|
1,74
|
1,45
|
1,02
|
2,05
|
2,09
|
1,56
|
|
Ultrafiltration (ml pour un 1,36%)
|
400
|
660
|
400
|
500
|
|
|
|
|
Ultrafiltration (ml pour un 3,86%)
|
1000
|
1280
|
1485
|
1290
|
1300
|
300
|
680
|
|
Protéines du dialysat (g/24 h)
|
5,5
|
23,7
|
7,46
|
7,2
|
4,7
|
11,8
|
|
Les chiffres de clairance entre parenthèses correspondent aux clairances
totales dialytique et rénale pour les patients ayant une diurèse
résiduelle.
On peut noter que les pertes protidiques dans le dialysat, à l’exception
de la patiente n° 3, restent dans la moyenne de celles relevées
habituellement en dialyse péritonéale.
La qualité de la dialyse chez nos patients est également comparable
à celle retrouvée habituellement en dialyse péritonéale
chez des patients ne souffrant pas d’hépatopathie. Les clairances
restent équivalentes à celles habituellement observées
en dialyse péritonéale continue ambulatoire [116]. On peut
observer que les clairances de l’urée et de la créatininémie
sont quasiment superposables, sans que la raison précise puisse en
être déterminée. Les clairances basses du patient n°
4 sont principalement dues au fait que ce patient était équilibré
avec trois échanges quotidiens seulement.
Nous avons également calculé les KT/V hebdomadaires de l’urée,
ce qui revient à ramener les clairances hebdomadaires au volume de
distribution de l’urée de façon à obtenir un index de
qualité de dialyse permettant les comparaisons entre patients. La
moyenne s’établit à 1,73±0,42, ce qui est comparable
aux résultats habituellement retrouvés chez nos patients. Les
variations individuelles sont cependant relativement importantes, et recouvrent
probablement deux faits : d’une part certains patients n’effectuent que trois
échanges quotidiens, et d’autre part le volume de distribution de
l’urée est particulièrement difficile à estimer chez
des patients en situation d’inflation hydrique du fait de l’ascite et parfois
d’œdèmes des membres inférieurs. Pour le calcul, nous avons
calculé ce volume de distribution en l’estimant à 58 % du poids
une fois obtenu l’assèchement de l’ascite.
Le recul important dont on dispose à propos des patients n° 5,
6 et 7 permet de vérifier l’excellente tolérance de la dialyse
sur le plan biologique et le peu d’influence des pertes protidiques du dialysat
sur la protidémie des patients:
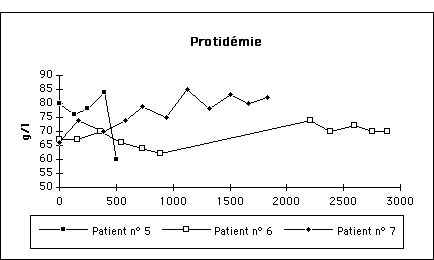
L’efficacité à long terme de la dialyse est attestée
par les courbes d’urée sanguine et de créatininémie
des patients qui restent à-peu-près stables au cours du temps:
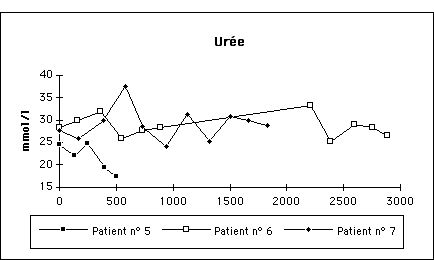
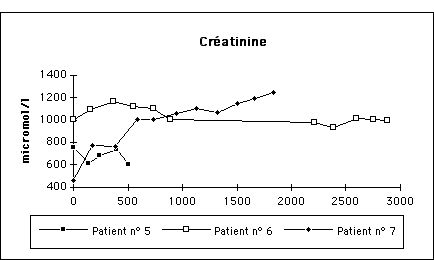
Chez le patient n° 7, l’élévation initiale de la créatininémie
correspond à la diminution de la fonction rénale résiduelle
et de la diurèse, puis à l’installation de l’anurie.
Du point de vue de la tolérance à long terme au traitement,
on peut noter que les taux de glycémie restent parfaitement raisonnable,
en dehors d’ “accidents” plus ou moins inévitables. La technique a
d’ailleurs parfaitement été supportée par le patient
n° 8 qui était diabétique, même s’il a fallu recourir
à l’insulinothérapie, le régime seul ne pouvant évidemment
suffire à équilibrer le diabète du fait des apports
glucidiques importants de la dialyse.
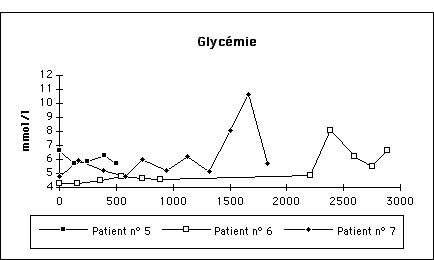
L’hémoglobine glycosylée a été surveillée
de façon itérative chez les patients n° 6 et 7. Les taux
retrouvés sont de 5,7 ± 0,49 % chez le patient n° 6 et
de 5,7 ± 0,65 % chez le patient n° 7 pour une normale de 4 à
5,6 %, soit des taux honorables étant donné les apports glucidiques.
Cependant le phénomène de carbamylation de l’hémoglobine
et l’anémie rencontrés au cours de l’insuffisance rénale
chronique ont été mis en cause comme rendant délicat
le dosage de l’hémoglobine glycosylée chez les patients insuffisants
rénaux. La fructosamine serait pour ces patients un témoin
plus fiable de l’équilibre glycémique [35]. La fructosamine
a été également surveillée chez ces deux patients.
Les taux retrouvés sont de 3,32±0,18 mmol/l chez le patient
n° 6 et de 2,72±0,2 mmol/l chez le patient n° 7 pour une normale
de 2,4 à 3,4 mmol/l.
Un autre critère de bonne qualité de dialyse et de vie est
le taux d’hémoglobine, qui reste également tout-à-fait
stable chez nos trois patients:
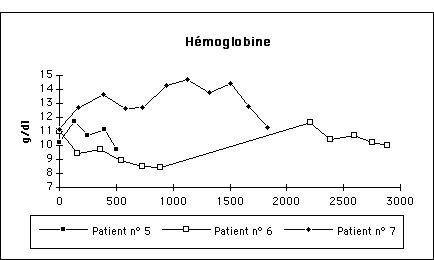
Ces résultats confirment le fait que la dialyse péritonéale
est la méthode qui permet le mieux de contrôler l’anémie
de l’insuffisance rénale. Les taux d’hémoglobine relevés
dans les séries des patients en dialyse péritonéale
sont en moyenne supérieurs d’un quart à ceux des patients en
hémodialyse [155].
Résultats cliniques
Les résultats de survie de nos malades sont particulièrement
impressionnants puisque nous avons 100 % de survie actuellement, le décès
après 3 ans de dialyse du patient n° 8 ne pouvant pas être
attribué à la technique. Que la dialyse soit instituée
pour une courte période ou au contraire qu’il s’agisse de dialyse
chronique, nous enregistrons d’excellents résultats. Nous allons reprendre
les résultats des différentes séries que nous avons
déjà recensées depuis 1979 en distinguant dialyse aiguë
et dialyse chronique.
Résultats en dialyse aiguë
|
Série
|
Hépatopathie
|
Néphropathie
|
Durée de dialyse
|
Devenir
|
|
Clark [26]
|
Cirrhose |
SHR |
10 jours |
Récupération |
| Mactier [96] |
Hépatite aiguë |
? |
2 jours |
Récupération |
| Hépatite aiguë |
? |
20 jours |
Récupération |
| Hépatite aiguë |
? |
4 jours |
Récupération |
| Hépatite aiguë |
? |
14 jours |
Décès (nécrose hépatique)
|
| Poulos [118] |
Cirrhose éthylique |
SHR |
5 semaines |
Récupération initiale, puis syndrome néphrotique
|
| Hépatite aiguë |
SHR |
3 semaines |
Récupération |
| Cas personnels (Freida [54]) |
Cirrhose éthylique |
GNA |
1 semaine |
Récupération |
| Cirrhose éthylique |
GNA |
3 mois |
Récupération |
| Hépatopathie éthylique |
SHR |
13 jours |
Récupération |
SHR: Syndrome hépatorénal GNA: Glomérulonéphrite
aiguë
Nous retrouvons 10 patients au total, dont 9 excellents résultats:
90 % de survivants et récupération d’une fonction rénale
normale dans tous ces cas, avec cependant l’apparition chez une des patientes
de Poulos [118] d’un syndrome néphrotique avec une insuffisance rénale
modérée mais stable dans les trois années qui ont suivi
l’épisode aigu initial, sans qu’il soit précisé dans
l’article si les deux pathologies sont liées. L’un des patients de
Mactier [96], souffrant d’une hépatite virale fulminante, est décédé
d’une nécrose hépatique massive.
Résultats en dialyse chronique
|
Série
|
Hépatopathie
|
Néphropathie
|
Recul en dialyse
|
Devenir
|
|
Segaert [139]
|
Cirrhose post-HB |
GNC |
20 mois |
Décès (encéphalopathie) |
| Marcus [101] |
Hépatopathie éthylique |
Petits reins |
4 ans |
Décès (empyème) |
| Cirrhose |
PKR |
8 ans |
HD (péritonite sclérosante) |
| Cirrhose |
PKR |
18 mois |
DPCA |
| Hépatopathie éthylique |
Sclérose glomérulaire |
2 ans |
DPCA |
| Hépatopathie éthylique |
SHR ? |
2 ans |
DPCA |
| Hépatite chronique |
Petits reins |
2 mois |
Décès |
| Hépatopathie éthylique |
Néphropathie diabétique |
9 mois |
HD (incapacité à se prendre en charge)
|
| Amylose primitive |
Amylose |
4 mois |
Décès (arrêt cardiaque) |
| Cirrhose éthylique |
SHR |
3 mois |
Décès (encéphalopathie) |
| Cas personnels (Freida [54] et Durand [36])
|
Cirrhose éthylique |
GNC |
3 mois |
HD (autolyse) |
| Cirrhose éthylique |
GNC |
3 ans |
DPCA |
| Cirrhose |
GNC |
12 ans |
DPCA |
| Cirrhose post-HB |
GNC |
7 ans |
DPCA |
| Cirrhose éthylique |
GNC ou néphroangiosclérose ? |
3 ans |
Décès (adénocarcinome hépatique)
|
HD: hémodialyse DPCA: dialyse péritonéale
continue ambulatoire GNC: Glomérulonéphrite chronique
HB: Hépatite B SHR: Syndrome hépatorénal PKR:
Polykystose rénale
En dialyse chronique, les résultats peuvent sembler moins probants.
Nous retrouvons au total 15 patients qui ont tous survécu au moins
2 mois à la mise en dialyse (survie moyenne de 37 mois en dialyse
péritonéale), soit au total 46 années-patients d’application
de la technique. 6 sont actuellement décédés, après
en moyenne 19 mois de dialyse. 3 ont dû être transférés
en hémodialyse pour diverses raisons. 6 sont encore dialysés
en dialyse péritonéale. La coexistence d’une insuffisance rénale
et d’une hépatopathie sévère est habituellement grevée
d’une mortalité très importante à court terme et ces
résultats restent donc très bons.
La qualité de vie en dialyse péritonéale est également
considérée habituellement comme très acceptable. Il
faut néanmoins garder à l’esprit que nous avons souvent affaire
à des patients psychologiquement fragiles, ainsi que le soulignent
la tentative d’autolyse du patient n° 4, manifestement dirigée
dans ses modalités contre la dialyse péritonéale, et
l’incapacité manifeste d’une des patientes de Marcus à se prendre
en charge, imposant son transfert en hémodialyse après 9 mois
de dialyse. Les bons résultats cliniques de notre série n’ont
été obtenus à long terme que chez les patients dont
nous avons pu obtenir le sevrage éthylique.
Discussion
Nous allons d’abord reprendre point par point les difficultés mises
en avant dans les séries les plus anciennes et ayant entraîné
jusqu’à ces dernières années le quasi-abandon de la
dialyse péritonéale chez les patients souffrant d’hépatopathie
grave, en les comparant à nos données personnelles et à
celles publiées récemment dans la littérature.
Abord péritonéal
L’accès péritonéal n'a jamais constitué une
véritable préoccupation chez nos patients et les troubles de
la coagulation, certes présents chez eux, n’ont pas entraîné
de complications hémorragiques. Il n’y a pas eu non plus de plaie
intestinale.
Dans la série de Marcus [101], les neuf cathéters ont tous
été placés par voie percutanée en position paramédiane
par l’équipe médicale. Avant 1985, Marcus utilisait un trocart
en acier, et après 1985, un guide métallique avec une gaine
amovible. Il n’a rencontré aucune complication hémorragique
sérieuse et il n’y a eu aucune plaie intestinale.
Le recours à une technique percutanée nous paraît parfaitement
réalisable dès lors que l'on utilise une procédure limitant
au maximum l'effraction pariétale, dans la mesure où les pathologies
en cause sont susceptibles d’être réversibles à brève
échéance, la technique chirurgicale restant évidemment
préférable en cas de mise en dialyse chronique. Cette technique
est d’ailleurs préconisée par de nombreux auteurs en ce qui
concerne la mise en place d’un cathéter péritonéal chez
les cirrhotiques dans le cadre du traitement de l’ascite réfractaire
par filtration et réinfusion de l’ascite [101]. Nous avons habituellement
recours à la ponction de la cavité péritonéale
à l'aide d'un trocart de petit calibre destiné à la
mise en place d'un guide métallique. L'effraction pariétale
est ainsi minimisée par rapport au risque de blessures des veines
collatérales susceptibles d’être causées par le trocart
de Tenckhoff, et autorise après dilatation du trajet transpariétal
la mise en place non traumatique d’un cathéter à deux manchons.
Il faut toutefois souligner que l’expérience de l’opérateur
est le facteur primordial de la réussite de la mise en place sans
incident du cathéter de dialyse par cette méthode. Une antibioprophylaxie
est recommandée pour éviter les complications infectieuses
au niveau du tunnel.
Complications septiques
Dans notre série, l’incidence des péritonites s’établit
à 13 épisodes pour 168 mois-patients, soit un épisode
tous les 13 mois-patients en moyenne. Cependant ce chiffre doit être
pondéré en raison de l’apparition des dispositifs déconnectables
à usage unique. On n’observe plus alors que 6 épisodes pour
120 mois-patients, soit 1 épisode tous les 20 mois-patients, chiffre
superposable à celui des infections péritonéales observées
habituellement en dialyse péritonéale. La plupart de ces péritonites,
quand un germe a pu être mis en évidence, sont des péritonites
à Staphylocoque (3 à Staphylocoque coagulase-positive et 3
à Staphylocoque coagulase-négative), en relation le plus souvent
avec une infection du tunnel ou une faute de manipulation. Il a été
noté un épisode de péritonite à Escherichia Coli
chez le patient n° 4 et un épisode de péritonite à
Serratia chez le patient n° 6, pouvant être éventuellement
d’origine porto-cave.
Dans la série publiée par Marcus [101], l’incidence de péritonite
est de 1 épisode tous les 15 mois-patients en moyenne. Dans cette
série, on retrouve 7 péritonites à Staphylocoque coagulase-négative,
1 péritonite à Staphylocoque coagulase-positive, 4 péritonites
à Escherichia Coli et 1 péritonite à un germe gram-négatif
non identifié. Dans deux cas, il n’a pas été retrouvé
de germe. Toutes ces péritonites ont pu être traitées
avec succès par une antibiothérapie locale sans nécessiter
de changement de cathéter.
La patiente de Segaert [139] a par contre connu un nombre anormalement élevé
de péritonites, toutes à Staphylocoque. Cependant elle était
prise en charge chez elle par son mari, âgé de 70 ans, et il
semble que ces péritonites soient toutes dues à des fautes
de manipulation.
Dans la série de Mactier en 1986 [96], on retrouve une péritonite
à Staphylocoque coagulase-négative, traitée par ablation
du cathéter et traitement antibiotique intraveineux.
Les complications infectieuses les plus graves se retrouvent dans l’observation
plus ancienne (1979) de Clark et O’Leary [26] puisque dans ce cas on observe
une péritonite récidivant 4 semaines plus tard et compliquée
d’une pleurésie purulente droite. Il faut souligner qu’à cette
date les modalités modernes de la dialyse péritonéale
(et en particulier les dispositifs déconnectables) n’étaient
pas encore employées.
Nous avons déjà signalé l’importance de l’hygiène
des mains et des soins de l’émergence du cathéter en dialyse
péritonéale, ainsi que sur la nécessité de toujours
respecter un protocole très strict pour les échanges. Le cathéter
de dialyse est une porte ouverte sur l’extérieur, et la moindre faute
de manipulation est immédiatement sanctionnée. Ceci est d’autant
plus important quand on s’adresse à des patients éthyliques
qu’on espère pouvoir éduquer suffisamment pour qu’ils puissent
être pris en charge à domicile par eux-mêmes ou leur entourage.
Toutes nos séries montrent une nette prédominance des infections
à Staphylocoque sur les péritonites à germes Gram-négatif,
ce qui indique bien la primauté des infections exogènes par
rapport aux infections endogènes plus classiquement retrouvées
chez les patients ascitiques. Les résultats observés sont excellents
chez les patients dont la coopération a pu être obtenue de façon
correcte.
Pertes protéiques
Ainsi que nous l’avons déjà remarqué, les pertes protéiques
chez 5 de nos 8 patients restent dans la moyenne de celles observées
au cours de la dialyse péritonéale et le suivi avec parfois
un très long recul de trois des patients n’a pas montré de
baisse significative de leur protidémie. Il faut toutefois tempérer
ces résultats car nous n’avons pas de renseignements précis
sur leur albuminémie, ce qui serait plus significatif.
Dans le cas de la patiente n° 3, les pertes protidiques ont certes été
très importantes, mais la situation est toujours restée maîtrisable
par la perfusion d’albumine, procédure acceptable dans la mesure où
il s’agissait d’une situation de courte durée, la dialyse péritonéale
n’ayant duré que 13 jours.
Dans le cas de la patiente n° 1, les pertes protidiques sont malheureusement
inconnues. Cependant l’équipe n’a pas rencontré de difficulté
particulière en relation avec la protidémie de cette patiente,
dont la dialyse a également été de très courte
durée (une semaine).
Dans la série de Marcus [101], l’albuminémie est restée
stable pour 7 des 9 patients. Pour un des patients, elle a baissé
de 30 à 24 g/l en 4 ans, date à laquelle il est décédé
d’un empyème. Pour le dernier patient, le décès survenu
après deux mois de dialyse seulement n’a pas permis de suivre ce paramètre
de façon suffisamment précise.
La patiente de Segaert [139] a vu elle sa protidémie diminuer de
67 à 56 g/l. Il faut cependant souligner que cette patiente était
soumise à un régime hypoprotidique du fait de la survenue avant
sa mise en dialyse péritonéale de multiples épisodes
de coma hépatique avec hyperammoniémie.
Dans la série de Poulos [118] nous n’avons de renseignements que
sur une seule des deux patientes dont l’albuminémie est restée
stable pendant toute la durée de la période de dialyse péritonéale.
Un début d’explication à ces faibles pertes protidiques dans
le dialysat chez des patients réputés comme subissant des pertes
protidiques non négligeables dans le compartiment ascitique pourrait
être apporté par les travaux de Schaffner et Popper [134] que
nous avons déjà signalés dans le chapitre consacré
à la formation de l’ascite. Ces deux auteurs ont montré que
l’évolution des cirrhoses s’accompagne d’un phénomène
de capillarisation des sinusoïdes hépatiques qui diminue leur
perméabilité aux protéines, si bien que la richesse
en protéines de la lymphe hépatique diminue nettement avec
l’aggravation de la cirrhose. Chez la patiente n° 3, l’évolution
à long terme a montré qu’il s’agissait plus d’une hépatite
alcoolique aiguë sur une stéatose que d’une cirrhose déjà
installée, puisque le sevrage éthylique a permis de retrouver
une fonction hépatique normale. Si l’on suit les conclusions de Schaffner
et Popper, il est donc logique de retrouver chez cette patiente une ascite
riche en protéines, alors que chez les autres patients dont la cirrhose
est déjà ancienne, la baisse de la perméabilité
des sinusoïdes pour les protéines ne produit qu’une ascite relativement
pauvre en protéines, ce qui permet ainsi de limiter les pertes à
un niveau acceptable en dialyse péritonéale.
Efficacité des échanges transmembranaires
L’étude des performances péritonéales chez
ces patients fait apparaître un profil évocateur d'une hyperperméabilité
caractérisée par une saturation du dialysat atteignant 83 à
98 % à 4 heures pour l’urée. Parallèlement, une résorption
excessive du gradient de glucose contraste avec la production d'une ultrafiltration
nette mesurée qui atteint paradoxalement les valeurs supérieures
de la normale. Nous avons déjà évoqué la seule
étude publiée à ce jour sur l’exploration de la fonction
péritonéale chez les patients souffrant d’hépatopathie
chronique et qui est celle de l’équipe de Dadone en 1990 [29]. Cette
étude montre également une ultrafiltration élevée
chez les patients cirrhotiques avec une augmentation significative du transport
de la créatinine et des protéines, ainsi que l’absence totale
de corrélation entre l’ultrafiltration et l’absorption glucidique
ou entre l’ultrafiltration et la concentration en sodium du dialysat.
Bien que la coexistence d'une hypoalbuminémie et d'une hypertension
veineuse dans le secteur splanchnique tendent à s'imposer en première
hypothèse pour rendre compte d'un tel paradoxe, aucun résultat
publié à ce jour ne permet de supporter une telle hypothèse.
Bien au contraire, des études histopathologiques effectuées
au cours de nécropsies de patients cirrhotiques ascitiques ont fait
apparaître d'importants épaississements fibreux du péritoine
bien difficiles à concilier avec un tableau d’hyperperméabilité
[22].
Si l'on peut raisonnablement douter de l'origine transcapillaire d'une production
aussi importante d’ultrafiltration chez nos patients, comment interpréter
cette ultrafiltration paradoxalement élevée en présence
d'un gradient de dextrose effondré?
Il est certainement tentant de proposer la participation d'une baisse de
la pression oncotique plasmatique directement en rapport avec l’hypoalbuminémie.
Mais bien que l'explication de ce phénomène ne soit certainement
pas univoque, toutes les tentatives de mobiliser l'ascite cirrhotique par
des perfusions d'albumine ont été vouées à l’échec
[59]. De même de nombreux arguments expérimentaux semblent accréditer
l’idée que le capillaire splanchnique ne puisse pas être considéré
comme la source principale de l'ascite cirrhotique [53,57,71,89,100,102,105,124,142,164]
et par conséquent de l’ultrafiltration dialytique de nos patients.
En revanche il parait plausible d'imaginer que la résorption lymphatique
sous-diaphragmatique réduisant l’ultrafiltration nette de nos patients
en dialyse péritonéale puissent être ici compromise du
fait d'une saturation des voies de drainages lymphatiques thoraciques soumises
a une augmentation de flux pouvant atteindre 8 à 10l par jour chez
le cirrhotique. Tant que l'augmentation du flux lymphatique d'origine sinusoïdale
est compensé par les larges capacités de drainage des canaux
thoraciques l'ascite demeure pratiquement infraclinique tandis que le débordement
de ce dispositif s'accompagne d'une transsudation directe de la lymphe hépatique
au travers de la capsule hépatique (cf figure 8).
On peut rapprocher de nos résultats ceux de Ings et al. [73] et de
Rubin et al. [131] qui ont traité au début des années
1980 des cas d’ascites néphrogéniques par dialyse péritonéale
intermittente ou par dialyse péritonéale continue ambulatoire,
avec succès dans les sept cas où ils ont essayé cette
technique. Ils ont observé au début de la dialyse une fuite
protidique accrue avec une aggravation de l’hypoprotidémie, mais ce
phénomène semble se limiter de lui-même [61]. Ainsi dans
la série de Rubin [131] les pertes protidiques en dialyse péritonéale
continue ambulatoire ne sont que de 7 à 8 grammes par jour alors que
l’ascite était initialement très riche en protéines
ce qui entraînait des pertes quotidiennes de 16 à 40 g de protéines
par la technique des ponctions d’ascite itératives.
Mactier et Khanna ont bien établi que la résorption lymphatique
en dialyse péritonéale était à l'origine non
seulement d'une perte d'ultrafiltration nette de 18 % [95,97] mais aussi
d'une diminution du transfert de masse des solutés d'origine convective
amputant de 13 à 14% les clairances de l’urée et de la créatinine
chez des patients ayant une perméabilité péritonéale
normale [95,97]. D’après ces auteurs, une réduction du drainage
lymphatique permettrait soit d’accroître l’efficacité des échanges
de longue durée en dialyse péritonéale par l’augmentation
de l’ultrafiltration et de l’épuration des substances dissoutes, soit
de diminuer l’osmolarité des solutions de dialyse habituellement employées
[97]. Ces considérations théoriques rejoignent totalement nos
constatations cliniques de patients ayant à la fois une bonne ultrafiltration
et une bonne qualité de dialyse sans avoir besoin de solutions de
dialysat hypertoniques.
En corollaire de ces observations nous proposons l’hypothèse qu'une
augmentation paradoxale de l'ultrafiltration et des clairances péritonéales
chez le cirrhotique soit reliée aux perturbations de drainage de la
lymphe hépatique retentissant directement sur le compartiment intrapéritonéal.
Qualité de la dialyse
Ainsi que nous venons de le voir, les échanges péritonéaux
chez nos patients ascitiques se font de façon parfaitement satisfaisante.
En conséquence la qualité de la dialyse est également
tout-à-fait satisfaisante. Les clairances totales hebdomadaires de
la créatinine vont de 51 à 92 l/1,73 m2
et celles de l’urée de 51 à 94l/1,73 m2, soit des niveaux équivalents à
ceux des patients dialysés habituellement. Même à long
terme (13 ans de recul pour notre patient le plus ancien), les clairances
péritonéales n’ont pas changé significativement. La
qualité de la dialyse est également soulignée à
long terme par la stabilité de la créatininémie et de
l’urée sanguine, ainsi que par la stabilité de l’hémoglobine,
révélatrice du bon équilibre métabolique et nutritionnel
de nos patients. Les patients de la série de Marcus ont également
tous conservé un hématocrite stable aux alentours de 30 % sans
nécessiter de transfusion [101]. Il est de plus intéressant
de souligner que ces excellents résultats sont obtenus en dialysant
nos patients avec 4 échanges quotidiens de 2 litres de soluté
isotonique à 1,36 % de glucose (et même 3 échanges seulement
pour les patients n° 2, 4 et 5, cette dernière conservant une
diurèse résiduelle, ce qui peut expliquer des clairances de
l’urée et de la créatinine inférieures à celles
des autres patients en ce qui concerne les résultats de la dialyse
seule). Cette possibilité est offerte par le profil particulier en
dialyse de nos malades dont le péritoine hyperperméable permet
ces échanges particulièrement efficaces tout en conservant
paradoxalement une capacité importante d’ultrafiltration de l’eau.
Un résultat intéressant est fourni par l’article de Segaert
[139] qui compare les résultats obtenus en hémodialyse puis
en dialyse péritonéale chez sa patiente. Il note une diminution
de l’urée sanguine de plus de 50 % (de 30 ± 3,8 mmol/l à
14,5 ± 3 mmol/l) malgré une diminution des clairances hebdomadaires
mesurées de l’urée de 40 % par rapport à celles précédemment
mesurées en hémodialyse.
Dans son article, Mactier [96] fait état d’un bon contrôle
de la balance hydrique et de l’insuffisance rénale, sans plus de précisions.
Dans la série de Marcus [101] quatre patients ont eu au moins un
test d’équilibration. Les D/P de l’urée à 3 heures s’échelonnent
de 78 à 91 % (la moyenne obtenue dans le service de Marcus en dialyse
péritonéale étant de 81± 8 %). L’urée
sanguine est comprise entre 6,66 et 11,6 mmol/l pour 8 de ces 9 patients,
et entre 13,3 et 15,8 mmol/l pour le dernier. Les KT/V hebdomadaires de l’urée
vont de 0,9 à 2,7 (soit 1,51±0,58), ce qui correspond d’après
Marcus à des clairances relativement peu élevées. Il
précise cependant que ces résultats ont été obtenus
avant qu’il n’utilise dans son service les tests dynamiques pour optimiser
les prescriptions en dialyse. Les patients étant cliniquement et biologiquement
dialysés de façon adéquate malgré ces faibles
clairances, les paramètres de leur dialyse n’ont pas été
changés par la suite.
Les faibles clairances relevées dans les séries des années
1960 et 1970 et mise en avant parmi les causes d’échec de la dialyse
doivent probablement être rapportées au fait que la technique
utilisée à l’époque était la dialyse péritonéale
intermittente, dont l’efficacité est nettement inférieure à
celle de la dialyse péritonéale continue ambulatoire du fait
du moindre temps de contact péritonéal avec le dialysat, et
donc de dialyse proprement dite [155].
Avantages de la dialyse péritonéale
La dialyse péritonéale n’est, il est bon de le rappeler, qu’un
traitement purement substitutif. Son but, pour nos patients comme pour les
patients chez lesquels elle est plus communément employée,
est de compenser la défaillance de la fonction rénale et d’épurer
l’organisme des déchets métaboliques et de l’eau en excès.
Nous avons vu que les résultats étaient satisfaisants de ce
point de vue. Quels sont maintenant les avantages que l’on peut attendre
de la dialyse péritonéale par rapport à l’autre grande
technique d’épuration extra-rénale qu’est l’hémodialyse?
Chez nos patients, ils consistent principalement en une épuration
et en une ultrafiltration lentes et continues, n’entraînant donc pas
de problème tensionnel [101]. Il est vrai cependant qu’en reprenant
les séries les plus anciennes et plus particulièrement celle
de Wilkinson et al. [162] on observe quelques cas d’hypotension importante
en rapport avec la dialyse péritonéale, mais beaucoup moins
souvent qu’en hémodialyse. Ce type de difficulté n’est d’ailleurs
jamais mentionné dans les séries plus récentes. Le maître
mot en dialyse péritonéale est “équilibre”: pas de changement
des volumes intra- ou extra-cellulaires, ni de leur composition; respect
de la pression artérielle, du pH, de la natrémie, de la kaliémie,
de la chlorémie, de la calcémie [139]. De plus cette technique
permet un assèchement de l’ascite par une mobilisation directe et
évite l’emploi des anticoagulants [101]. Elle ne nécessite
pas un centre spécialisé ni un matériel coûteux,
et peut être entreprise dans tout service de médecine spécialisée,
si les praticiens et le personnel soignant sont formés à la
technique, évitant ainsi d’avoir à exposer un patient fragile
aux risques et aux délais d’un transfert vers un hôpital régional
[96]. D’un point de vue théorique, comme la membrane péritonéale
est perméable aux molécules jusqu’à 6 000 Daltons, la
dialyse péritonéale permet d’épurer l’organisme des
toxines impliquées dans le coma hépatique en cas d’insuffisances
hépatique et rénale conjuguées (l’ammoniac, le méthylmercaptane,
la bilirubine, les acides gras libres) [94,96]. Les clairances hebdomadaires
de ces molécules sont jusqu’à six fois plus importantes en
dialyse péritonéale continue ambulatoire qu’en hémodialyse
[116]. La dialyse péritonéale intermittente est considérée
comme le traitement de choix pour le traitement du coma hyperammoniémique
causé par les anomalies congénitales de la synthèse
de l’urée [13,96]. Même l’apport massif de glucose, par certains
côtés, peut être un avantage: il n’existe pas, contrairement
à ce qu’on observe en hémodialyse, de risque d’hypoglycémie;
il semblerait également que cet apport glucidique aurait un certain
effet régulateur et freinateur sur l’appétit, rendant ainsi
beaucoup plus faciles les prescriptions diététiques relatives
à l’insuffisance rénale [139].
Chapitre suivant
Table des matières